|
Dernière Mise à Jour
|
|
|
 |
 |
|
 |
|

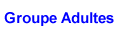
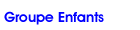
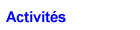

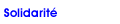
|
|
 |
 |
|
 |
|
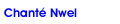
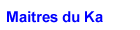
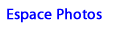

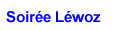
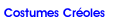 |
|
 |
 |
|
 |
|
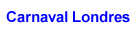

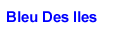

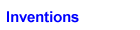 |
|
 |
 |
|
 |
|


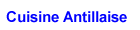
|
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
 |

|
 |
| |
Cheikh
Anta Diop naît
en 1923 dans un petit village du Sénégal, Caytou. L'Afrique est sous la
domination coloniale européenne qui a pris le relai de la traite négrière
atlantique commencée au 16ème siècle. La violence dont l'Afrique est
l'objet, n'est pas de nature exclusivement militaire, politique et
économique. Théoriciens (Voltaire, Hume, Hegel, Gobineau, Lévy Bruhl, etc.)
et institutions d'Europe (l'institut d'ethnologie de France créé en 1925 par
L. Lévy Bruhl, par exemple), s'appliquent à légitimer au plan moral et
philosophique l'infériorité intellectuelle décrétée du Nègre.
La vision
d'une Afrique anhistorique et atemporelle, dont les habitants, les Nègres,
n'ont jamais été responsables, par définition, d'un seul fait de
civilisation, s'impose désormais dans les écrits et s'ancre dans les
consciences.
L'Égypte est ainsi arbitrairement rattachée à l'Orient et au
monde méditerranéen géographiquement, anthropologiquement, culturellement.
Allocution de Cheikh Anta Diop
EN 1984, LE PROFESSEUR
CHEIKH ANTA DIOP S'ADRESSAIT AUX JEUNES DU NIGER ET RÉPONDAIT AVEC
ENGOUEMENT À LEURS QUESTIONS. PETIT À PETIT, IL REMARQUA QUE LEUR
PRÉOCCUPATION PRINCIPALE ÉTAIT DE CONNAÎTRE LE POINT DE VUE DES HISTORIENS
OCCIDENTAUX SUR LES SUJETS QU'IL ABORDAIT. SA RÉPONSE FUT DIGNE D'UN ESPRIT
SCIENTIFIQUE. POUR LUI, LA JEUNESSE NOIRE DOIT S'ARMER DE CONNAISSANCE ET
ÊTRE EN MESURE D'ÉTUDIER SCIENTIFIQUEMENT SON PASSÉ DE MANIÈRE MINUTIEUSE ET
OBJECTIVE EN SE RÉSERVANT LA PRIORITÉ DE SON JUGEMENT. C'EST AINSI QUE L'ON
SE PROUVE QUE L'ON A RÉUSSI À DOMPTER SA CONSCIENCE D'ESCLAVE.
18 août 2003
par
Jean-Philippe Omotunde
Nous vous proposons donc cette allocution suivie d'une
analyse approfondie.
« Je
crois que le mal que l'occupant nous a fait n'est pas encore guéri, voilà le
fond du problème. L'aliénation culturelle finit par être partie intégrante
de notre substance, de notre âme et quand on croit s'en être débarrassé on
ne l'a pas encore fait complètement.
Souvent le colonisé ressemble un peu, ou
l'ex-colonisé lui-même, à cet esclave du XIXème siècle qui libéré, va jusqu
'au pas de la porte et puis revient à la maison, parce qu'il ne sait plus où
aller. Il ne sait plus où aller... Depuis le temps qu'il a perdu la liberté,
depuis le temps qu'il a apprit des réflexes de subordinations, depuis le
temps qu'il a apprit à penser à travers son maître (...)
Toutes les questions que vous m'avez posé
reviennent à une seule. Quant est ce que les blancs vous reconnaîtront-ils ?
Parce que la vérité sonne blanche. Mais c'est dangereux ce que vous dites
parce que si réellement l'égalité intellectuelle est tangible, l'Afrique (et
la diaspora africaine) devrait sur des thèmes controversés (tels que
l'origine africaine de la première civilisation humaine), être capable
d'accéder à sa vérité par sa propre investigation intellectuelle et se
maintenir à cette vérité, jusqu'à ce que l'humanité sache que l'Afrique ne
sera plus frustrée, que les idéologues perdront leur temps, parce qu'ils
auront rencontré des intelligences égales qui peuvent leur tenir tête sur le
plan de la recherche de la vérité.
Mais vous êtes persuadé que pour qu'une
vérité soit valable et objective, il faut qu'elle sonne blanche. Mais ça,
c'est un repli de nôtre âme qu'il faut faire disparaître (...) Moi, si je
n'étais pas intiment persuadé de la capacité de chaque race à mener sa
destinée intellectuelle et culturelle, mais je serai déçu, que ferions nous
dans le monde. S'il y avait réellement cette hiérarchisation intellectuelle,
il faudrait nous attendre à notre disparition d'une manière ou d'une autre.
Parce que le conflit, il est partout jusque dans nos relations
internationales les plus feutrées. Nous menons et on mène contre nous le
combat le plus violent, plus violent même que celui qui a conduit à la
disparition de certaines espèces. Il faut justement que votre sagacité
intellectuelle aille jusque là (...) Il n'y a qu'un seul salut, c'est la
connaissance directe et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet
effort (...)
A formation égale, la vérité triomphe.
Formez-vous, armez-vous de sciences jusqu'aux dents (...) et arrachez votre
patrimoine culturel. Ou alors traînez-moi dans la boue, si quand vous
arrivez à cette connaissance directe vous découvrez que mes arguments sont
inconsistants, c'est cela, mais il n'y a pas d'autre voie. ».
ANALYSE
Le point de
vue d'Emmanuel KANT
Le point de
vue de Frantz FANON
Conclusion
Tant que nous ne maîtriserons pas les données
scientifiques relatives à notre patrimoine historique, culturel et
économique, nous demeurerons des marionnettes insouciantes et inconscientes.
Jean-Philippe Omotunde
|
|
Les principales thématiques développées par Cheikh
Anta Diop
Les
thématiques présentes dans l'œuvre de Cheikh Anta Diop peuvent être
regroupées en six grandes catégories :
a. L'origine de
l'homme et ses migrations. Parmi les questions traitées :
l'ancienneté de l'homme en Afrique, le processus de différentiation
biologique de l’humanité, le processus de sémitisation, l’émergence des
Berbères dans l’histoire, l'identification des grands courants
migratoires et la formation des ethnies africaines.
b. La parenté Égypte
ancienne/Afrique noire. Elle est étudiée selon les aspects
suivants : le peuplement de la vallée du Nil, la genèse de la
civilisation égypto-nubienne, la parenté linguistique, la parenté
culturelle, les structures socio-politiques, etc.
c. La recherche
sur l'évolution des sociétés. Plusieurs développements
importants sont consacrés à la genèse des formes anciennes
d'organisation sociale rencontrées dans les aires géographiques
méridionale (Afrique) et septentrionale (Europe), à la naissance de
l'État,.à la formation et l'organisation des États africains après le
déclin de l'Égypte, à la caractérisation des structures politiques et
sociales africaines et européennes avant la période coloniale ainsi qu'à
leur évolution respective, aux modes de production, aux conditions
socio-historiques et culturelles qui ont présidé à la Renaissance
européenne.
d. L'apport de
l'Afrique à la civilisation. Cet apport est restitué dans de
nombreux domaines : la métallurgie, l'écriture, les sciences
(mathématiques, astronomie, médecine, ...), les arts et l'architecture,
les lettres, la philosophie, les religions révélées (judaïsme,
christianisme, islam), etc.
e. Le
développement économique, technique, industriel, scientifique,
institutionnel, culturel de l'Afrique. Toutes les questions
majeures que pose l'édification d'une Afrique moderne sont abordées :
maîtrise des systèmes éducatif, civique et politique avec l'introduction
et l'utilisation des langues nationales à tous les niveaux de la vie
publique ; l'équipement énergétique du continent ; le développement de
la recherche fondamentale ; la représentation des femmes dans les
institutions politiques ; la sécurité ; la construction d'un État
fédéral démocratique, etc. La création par Cheikh Anta Diop du
laboratoire de datation par le radiocarbone qu'il dirige jusqu'à sa
disparition est significative de toute l'importance accordée à "l'enracinement
des sciences en Afrique".
f.
L'édification d'une civilisation planétaire. L'humanité doit
rompre définitivement avec le racisme, les génocides et les différentes
formes d’esclavage. La finalité est le triomphe de la civilisation sur
la barbarie. Cheikh Anta Diop appelle de ses vœux l'avènement de l'ère
qui verrait toutes les nations du monde se donner la main "pour bâtir
la civilisation planétaire au lieu de sombrer dans la barbarie" (Civilisation
ou Barbarie, 1981). L’aboutissement d’un tel projet suppose :
- la dénonciation de la
falsification moderne de l'histoire : "La conscience de l'homme
moderne ne peut progresser réellement que si elle est résolue à
reconnaître explicitement les erreurs d'interprétations scientifiques,
même dans le domaine très délicat de l'Histoire, à revenir sur les
falsifications, à dénoncer les frustrations de patrimoines. Elle
s'illusionne, en voulant asseoir ses constructions morales sur la plus
monstrueuse falsification dont l'humanité ait jamais été coupable tout
en demandant aux victimes d'oublier pour mieux aller de l'avant"
(Cheikh Anta Diop, Antériorité des civilisations nègres – mythe ou
vérité historique ?, Paris, Présence Africaine, p. 12).
- la réaffirmation de
l'unité biologique de l'espèce humaine fondement d’une nouvelle
éducation qui récuse toute inégalité et hiérachisation raciales :
"... Donc, le problème est de rééduquer notre perception de l'être
humain, pour qu'elle se détache de l'apparence raciale et se polarise
sur l'humain débarrassé de toutes coordonnées ethniques." (Cheikh
Anta Diop, "L'unité d'origine de l'espèce humaine", in Actes du
colloque d'Athènes : Racisme science et pseudo-science, Paris,
UNESCO, coll. Actuel, 1982, pp. 137-141).
L'ensemble de ces grandes
problématiques définit de façon claire et cohérente un cadre, des axes
et un programme de travail.
|
|
L'apport méthodologique et les acquis du colloque du Caire
Pour
sortir l'Afrique du paradigme anhistorique et ethnographique dans lequel
anthropologues et africanistes l'avaient confinée Cheikh Anta Diop adopte
une méthodologie de recherche qui s'appuie sur des études diachroniques, le
comparatisme critique, la pluridisciplinarité : archéologie, linguistique,
ethnonymie/toponymie, sociologie, sciences exactes, etc.. Grâce à une
approche à la fois analytique et synthétique il lui a été possible de rendre
aux faits historiques, sociologiques, linguistiques, culturels du continent
africain, leur cohérence et leur intelligibilité. La nouvelle méthodologie
en matière d'histoire africaine que préconise et met en œuvre Cheikh Anta
Diop dans ses travaux est exposée dans son livre Antériorité des
civilisations nègres – mythe ou vérité historique ?, (op. cit.,
pp. 195-214) et largement commentée par le professeur Aboubacry Moussa Lam
(cf. bibliographie).
S'agissant de l'Égypte ancienne
alors étudiée dans son contexte négro-africain, Cheikh Anta Diop écrit :
"Partant de l'idée que
l'Égypte ancienne fait partie de l'univers nègre, il fallait la vérifier
dans tous Ies domaines possibles, racial ou anthropologique, linguistique,
sociologique, philosophique, historique, etc. Si l'idée de départ est
exacte, l'étude de chacun de ces différents domaines doit conduire à la
sphère correspondante de l'univers nègre africain. L'ensemble de ces
conclusions formera un faisceau de faits concordants qui éliminent le cas
fortuit. C'est en cela que réside la preuve de notre hypothèse de départ.
Une méthode différente n'aurait conduit qu'à une vérification partielle qui
ne prouverait rien. Il fallait être exhaustif" (Cheikh Anta Diop,
Antériorité des civilisations nègres – mythe ou vérité historique ?,
Paris, Présence Africaine, 1967, p. 275).
En 1970, l'UNESCO sollicite
Cheikh Anta Diop pour devenir membre du Comité scientifique international
pour la rédaction d'une Histoire générale de l'Afrique. Son exigence
d'objectivité le conduit à poser trois préalables à la rédaction des
chapitres consacrés à l'histoire ancienne de l'Afrique. Les deux premiers
consistent en la tenue d'un colloque international, organisé par l'UNESCO,
réunissant des chercheurs de réputation mondiale, pour d'une part, traiter
de l'origine des anciens Égyptiens, et d'autre part faire le point sur le
déchiffrement de l'écriture méroïtique. En effet, une confrontation des
travaux de spécialistes du monde entier lui paraissait indispensable pour
faire avancer la science historique. Le troisième préalable concerne la
réalisation d'une couverture aérienne de l'Afrique afin de restituer les
voies anciennes de communication du continent.
C'est ainsi que se tient au
Caire du 28 janvier au 3 février 1974, organisé par l'UNESCO dans le cadre
de la Rédaction de l'Histoire générale de l'Afrique, le colloque
intitulé : "Le peuplement de l'Égypte ancienne et le déchiffrement de
l'écriture méroïtique".
Ce colloque rassemble une
vingtaine de spécialistes appartenant aux pays suivants : Égypte, Soudan,
Allemagne, USA, Suède, Canada, Finlande, Malte, France, Congo et Sénégal. La
contribution très constructive des chercheurs africains tant au plan
méthodologique qu'au niveau de la masse des faits apportés et instruits, a
été reconnue par les participants et consigné dans le compte-rendu du
colloque, notamment dans le domaine de la linguistique : "un large accord
s'est établi entre les participants". "Les éléments apportés par les
professeurs DIOP et OBENGA ont été considérés comme très constructifs. (…)
Plus largement, le professeur SAUNERON a souligné l'intérêt de la méthode
proposée par le professeur OBENGA après le professeur DIOP. L'Égypte étant
placée au point de convergence d'influences extérieures, il est normal que
des emprunts aient été faits à des langues étrangères ; mais il s'agit de
quelques centaines de racines sémitiques par rapport à plusieurs milliers de
mots. L'égyptien ne peut être isolé de son contexte africain et le sémitique
ne rend pas compte de sa naissance ; il est donc légitime de lui trouver des
parents ou des cousins en Afrique."[cf. Histoire générale de
l’Afrique, Paris, Afrique/Stock/Unesco, 1980, pp. 795-823].
S'agissant de la culture
égyptienne : "Le professeur VERCOUTTER a déclaré que, pour lui, l'Égypte
était africaine dans son écriture, dans sa culture et dans sa manière de
penser. Le professeur LECLANT a reconnu ce même caractère africain dans le
tempérament et la manière de penser des Égyptiens."
Le rapport, dans sa conclusion
générale indique que "La très minutieuse préparation des communications
des professeurs Cheikh Anta DIOP et OBENGA n'a pas eu, malgré les précisions
contenues dans le document de travail préparatoire envoyé par l'UNESCO, une
contrepartie toujours égale. Il s'en est suivi un véritable déséquilibre
dans les discussions."
Depuis 1974, les découvertes
archéologiques, les études linguistiques, les études génétiques, l'examen de
la culture matérielle, l'étude de la philosophie, etc. ne font que confirmer
chaque jour davantage les grandes orientations de recherche recommandées par
le Colloque du Caire.
La postérité intellectuelle
Dans
le domaine de l'égyptologie, par exemple, une communauté d'égyptologues
africains existe désormais. Elle s’est constituée selon les étapes ci-après.
La période de la
recherche solitaire 1946-1970
Jusqu'au
début des années 1970, Cheikh Anta Diop poursuit, dans une totale solitude
intellectuelle, ses recherches sur la parenté existant entre l'Égypte
ancienne et le reste de l'Afrique noire engagées déjà depuis plus d'une
vingtaine d'années. Un veto s'oppose implacablement à ce qu'il enseigne à
l'Université de Dakar. Deux conséquences immédiates en découlent :
l'impossibilité d'orienter et de former les jeunes générations d'historiens
et d'égyptologues africains, et celle de procéder au renouvellement complet
des "Études africaines" tant sur le plan du contenu de l'enseignement
(intégration des antiquités égypto-nubiennes, etc.) que sur celui des
critères de compétence.
Théophile Obenga rencontre Cheikh Anta Diop
Au
début des années 60, Théophile Obenga, découvre le livre de Cheikh Anta Diop
Nations nègres et Culture. Théophile Obenga, est déjà formé à la
philosophie et il maîtrise le grec ancien ainsi que le latin. Il s'oriente
de manière décisive vers l'égyptologie et la linguistique. Il suit les
enseignements de grands noms de la linguistique historique comme Henri Frei
à l'Université de Genève et Émile Benveniste au Collège de France à Paris.
Les premiers résultats des recherches de Théophile Obenga en histoire et en
linguistique paraissent dans des articles dès 1969. C'est en 1973, qu'il
publie aux Éditions Présence Africaine son premier grand livre, L'Afrique
dans l'Antiquité - Égypte pharaonique/Afrique Noire. Le lecteur y
trouvera entre autres des chapitres fondamentaux consacrés à la comparaison
de la langue égyptienne ancienne et des langues négro-africaines
contemporaines, ainsi qu'aux écritures anciennes du continent africain.
Cheikh Anta Diop n'est désormais
plus seul. Il le sait et il exprime l'espoir, dans sa préface au livre de
Théophile Obenga, de voir se constituer à terme une équipe de chercheurs
africains : "Il est indispensable de créer une équipe de chercheurs
africains où toutes les disciplines sont représentées. C'est de la sorte
qu'on mettra le plus efficacement possible la pensée scientifique au service
de l'Afrique.", avec la mise en garde préalable suivante : "Puissent-ils
comprendre qu'à la maîtrise des connaissances il faut ajouter l'efficacité
de l'organisation pour se maintenir".
Le colloque du Caire (1974)
évoqué plus haut consolide la collaboration entre les deux hommes pour la
réécriture de l'histoire de l'Afrique et partant de l'humanité, sur des
bases strictement objectives.
Les acquis du colloque du Caire
provoquent des fissures dans le dispositif d'isolement dressé autour de
Cheikh Anta Diop. La technicité du débat scientifique, dévoile jour après
jour, l'incompétence et l'imposture africaniste qui se réfugie de manière
malsaine, hier comme aujourd'hui encore, dans une pseudo critique à
caractère psychanalytique ou dans le procès d'intention.
Cheikh Anta Diop et Théophile
Obenga se sont attachés, parallèlement à leurs recherches, à sensibiliser
les Africains à l'histoire de l'Afrique avant la colonisation, aux enjeux
vitaux qui lui sont associés, à faire naître des vocations, au moyen de
conférences, de colloques, de longues interviews en Afrique, en Europe, dans
les Caraïbes, aux États-Unis.
Au fil des années des Africains
se sont engagés dans la voie de l'égyptologie, tout en se heurtant, d’une
part à l’hostilité du milieu universitaire, notamment francophone, où une
telle orientation est "politiquement incorrecte" et d’autre part à la
faiblesse des moyens matériels.
Les continuateurs. L'École
africaine d'égyptologie
Une
école africaine d'égyptologie s'est progressivement constituée. C'est le
lieu de souligner, ici, toute l'importance que revêt la connaissance de
l'intérieur de l'univers négro-africain, particulièrement à la langue, la
culture matérielle, les conceptions philosophiques, religieuses et
socio-politiques. On touche donc du doigt les critères mêmes que doit
satisfaire un spécialiste véritable de l'Afrique ancienne.
Les grandes orientations de
travail de l'école africaine d'égyptologie recouvrent les thématiques
développées par Cheikh Anta Diop, rappelées plus haut, ainsi que les
recommandations du colloque d'Égyptologie du Caire. Les résultats les plus
récents des recherches linguistiques, culturelles de manière générale sur la
civilisation pharaonique alliés à ceux des recherches archéologiques
illustrent la pertinence scientifique du cadre de travail négro-africain,
son caractère éminemment fécond. La revue ANKH, Revue d'égyptologie et
des civilisations africaines, a justement pour vocation de
publier de tels acquis. ANKH signifie la "Vie" en langue égyptienne
pharaonique. Créée en 1992, elle est dirigée par le professeur Théophile
Obenga. Les collaborateurs de ANKH sont des chercheurs de divers pays,
marque de son ouverture internationale. On y trouvera, outre les études
consacrées à l’Antiquité égypto-nubienne (linguistique, culture matérielle,
philosophie, religion, archéologie,...), des synthèses sur l'Afrique en
général, une section sciences exactes (physique, mathématiques,
informatique, ...), et une rubrique bibliographique. Parallèlement, toute
une série d’ouvrages traduit la richesse de la recherche égyptologique
africaine (cf. bibliographie). Cette production intellectuelle de haut
niveau s’enrichit chaque année de nouvelles études et constitue la base
nécessaire d’un enseignement de qualité sur l'Afrique ancienne.
En 1981, Cheikh Anta Diop est
enfin nommé professeur d'histoire associé à la Faculté des Lettres et
Sciences Humaines de Dakar, c’est-à-dire vingt sept ans après la parution de
Nations nègres et Culture, vingt et un ans après son Doctorat d'État.
Il y enseignera en maîtrise, en DEA et dirigera des thèses jusqu'à sa
disparition en 1986. La relève est assurée aujourd'hui par Aboubacry Moussa
Lam et Babacar Sall, égyptologues à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.
Sollicités par nombre de clubs,
de cercles d’études, d'associations comme les Générations Cheikh Anta Diop
du Burkina-Faso, du Niger, du Mali, du Sénégal, les égyptologues africains
assurent également une vulgarisation sur l’histoire ancienne de l’Afrique à
travers cours, conférences,
séminaires, expositions organisés en Afrique, aux États-Unis, dans les
Caraïbes, en Europe.
La jeunesse africaine du
continent et de la diaspora est désormais édifiée sur la période de son
histoire qui précède les quatre siècles de la traite négrière atlantique et
d'occupation coloniale, jusqu'aux périodes les plus reculées. L'œuvre de
Cheikh Anta Diop montre la nécessité pour l'Afrique d'un retour à l'Égypte
ancienne dans tous les domaines : celui des sciences, de l'art, de la
littérature, du droit, ... La démarche historique, loin d'être conçue comme
un repli sur soi ou une simple délectation du passé, permet à Cheikh Anta
Diop de définir le cadre de réflexion approprié pour poser, en termes
exacts, l'ensemble des problèmes culturels, éducatifs, politiques,
économiques, scientifiques, techniques, industriels, etc., auxquels sont
confrontés les Africains, aujourd'hui, et pour y apporter des solutions.
C'est pourquoi toute son œuvre se présente comme le socle même d’une
véritable renaissance de l'Afrique :
"[Et] les études
africaines ne sortiront du cercle vicieux où elles se meuvent, pour
retrouver tout leur sens et toute leur fécondité, qu'en s'orientant vers la
vallée du Nil. Réciproquement, l'égyptologie ne sortira de sa sclérose
séculaire, de l'hermétisme des textes, que du jour où elle aura le courage
de faire exploser la vanne qui l'isole, doctrinalement, de la source
vivifiante que constitue, pour elle, le monde nègre" (Antériorité des
civilisations nègres - mythe ou vérité historique ?, op. cit., p.
12).
|
|
Oeuvre de Cheikh Anta Diop
: contexte
historique et idéologique
C'est donc dans un contexte
singulièrement hostile et obscurantiste que Cheikh Anta Diop est conduit
à remettre en cause, par une investigation scientifique méthodique, les
fondements mêmes de la culture occidentale relatifs à la genèse de
l'humanité et de la civilisation. La renaissance de l'Afrique, qui
implique la restauration de la conscience historique, lui apparaît comme
une tâche incontournable à laquelle il consacrera sa vie.
C’est ainsi qu’il s'attache,
dès ses études secondaires à Dakar et St Louis du Sénégal, à se doter
d'une formation pluridisciplinaire en sciences humaines et en sciences
exactes, nourrie par des lectures extrêmement nombreuses et variées.
S'il
acquiert une remarquable maîtrise de la culture européenne, il n'en est
pas moins profondément enraciné dans sa propre culture. Sa parfaite
connaissance du wolof, sa langue maternelle, se révèlera être l'une des
principales clés qui lui ouvrira les portes de la civilisation
pharaonique. Par ailleurs, l'enseignement coranique le familiarise avec
le monde arabo-musulman.
A partir des connaissances
accumulées et assimilées sur les cultures africaine, arabo-musulmane et
européenne, Cheikh Anta Diop élabore des contributions majeures dans
différents domaines. L'ensemble se présente comme une œuvre cohérente et
puissante qui fait de Cheikh Anta Diop un savant et un humaniste.
On se propose dans une
première partie de dégager de manière concise quelques-uns des traits
essentiels de son œuvre. En second lieu, on présente la poursuite de
l'œuvre du savant dans le domaine de l'histoire et de l'égyptologie.
A. L'œuvre de Cheikh Anta
Diop
La
reconstitution scientifique du passé de l'Afrique
et la
restauration de
la conscience historique
Au
moment où Cheikh Anta Diop entreprend ses premières recherches
historiques (années 40) l'Afrique noire ne constitue pas "un champ
historique intelligible" pour reprendre une expression de
l'historien britannique Arnold Toynbee. Il est symptômatique qu'encore
au seuil des années 60, dans le numéro d'octobre 1959 du Courrier de
l'UNESCO, l'historien anglo-saxon Basile Davidson introduise son propos
sur la "Découverte de l'Afrique" par la question : "Le Noir
est-t-il un homme sans passé ?"
Dans son récent ouvrage
Cheikh Anta Diop, Volney et le Sphinx, Théophile Obenga montre
magistralement en quoi consiste l'originalité et la nouveauté de la
problématique historique africaine ouverte et développée par Cheikh Anta
Diop :
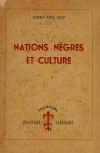
"En refusant le schéma
hégélien de la lecture de l'histoire humaine, Cheikh Anta Diop s'est par
conséquent attelé à élaborer, pour la première fois en Afrique noire une
intelligibilité capable de rendre compte de l'évolution des peuples
noirs africains, dans le temps et dans l'espace [...] Un ordre
nouveau est né dans la compréhension du fait culturel et historique
africain. Les différents peuples africains sont des peuples
"historiques" avec leur État : l'Égypte, la Nubie, Ghana, Mali,
Zimbabwe, Kongo, Bénin, etc. leur esprit, leur art, leur science. Mieux,
ces différents peuples historiques africains s'accomplissent en réalité
comme des facteurs substantiels de l'unité culturelle africaine".
[Théophile Obenga, Leçon inaugurale du colloque de Dakar de février-mars
1996 intitulé : "L'œuvre de Cheikh Anta Diop - La Renaissance de
l'Afrique au seuil du troisième millénaire", Actes du colloque de
Dakar à paraître).
Nations nègres et Culture
– De l'Antiquité nègre égyptienne aux problèmes culturels de l'Afrique
d'aujourd'hui– que publie en 1954 Cheikh Anta Diop aux Éditions
Présence Africaine créées par Alioune Diop est le livre fondateur d'une
écriture scientifique de l’histoire africaine. La reconstitution
critique du passé de l'Afrique devient possible grâce à l'introduction
du temps historique et de l'unité culturelle. La
restauration de la conscience historique devient alors elle aussi
possible.
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
|
|