Dernière Mise à Jour |
|
 |
 |
|
 |
|

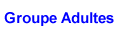
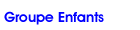
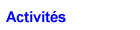
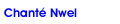

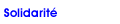
|
|
 |
 |
|
 |
|

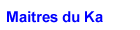
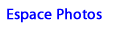

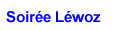
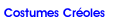 |
|
 |
 |
|
 |
|
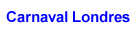

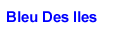

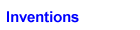 |
|
 |
 |
|
 |
|


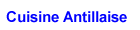
|
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
 |

|
 |
| |
|
Costumes Créoles
Mode et Vêtements Traditionnels des Antilles Françaises
Tout de coquetterie, de grâce,
d'élégance et d'indolence, la femme Antillaise apparaît dans toute sa
splendeur.
|
La Grande Robe,
toujours réalisée dans un tissu
coloré où brillant, elle était portée avec un jupon et
une cape de la même teinte.
La Douillette
Robe
de tous les jours, elle était constituée d'un
jupon, d'une robe serrée à la taille en
cotonnade fleurie, à carreaux ou à rayures.
La Titane,
vêtement porté
par les courtisanes de l'époque. Provocantes,
elles n'hésitaient pas à porter une chemise
en dentelle largement échancrée sur
la poitrine et découvrant leurs épaules.
La Cotonnade,
en madras
calandé, elle pouvait être en velours ou en
satin les jours de fête.
|
DODYSHOP,
boutique en ligne de
tenues
 créoles
vous propose une large gamme de robes
créoles et vêtements madras,
coton ou broderie créole pour
fille. créoles
vous propose une large gamme de robes
créoles et vêtements madras,
coton ou broderie créole pour
fille.

Consultez le
catalogue en ligne de notre boutique
antillaise et choisissez votre modèle
créole préféré !
MARIAGE
Ambiance de luxe et d'élégance sur un fond de
traditions créoles pour les robes de
mariage signées DODY. C'est le
style antillais, la qualité, la
créativité. C'est le raffinement d'un détail. Le choix d'une matière. Quand
c'est aussi beau, c'est le mariage de la
broderie anglaise au coton, le
caresse de l'organza et la vivacité
du madras ... | | |
|

Vous
souhaitez un costume traditionnel, pour un mariage,
un cortège, pour vous déguiser à l'occasion d'une fête
costumée, d'une soirée à thème, d'un anniversaire etc...
nous pouvons le réaliser
pour vous, envoyés nous un courriel à:costumes@kamaniok.com
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
 |

|
 |
| |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
La coiffe
a toujours été l‘accessoire indispensable du costume créole.

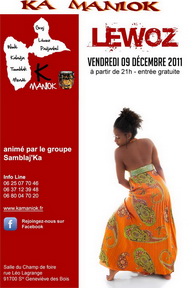 Elle reflétait soit la situation
sociale, soit les circonstances de la vie. La coiffe traditionnelle
de madras est née d’une frustration. En effet des lois interdisaient
aux affranchies de porter des chapeaux, ceux-ci étant réservés aux
femmes blanches. Elle reflétait soit la situation
sociale, soit les circonstances de la vie. La coiffe traditionnelle
de madras est née d’une frustration. En effet des lois interdisaient
aux affranchies de porter des chapeaux, ceux-ci étant réservés aux
femmes blanches.
A une époque où se couvrir la tête
était une marque de bienséance, les femmes créoles n’avaient pas le
choix, elles devaient porter le foulard, ce qu’elles ressentaient
comme une humiliation.
Les chapeaux étaient interdits aux
affranchies
C’est ainsi qu’elles inventèrent la
coiffe de madras qui allait devenir la coiffe traditionnelle. C’est
un carré de tissu à carreaux, aux couleurs vives, drapé autour de la
tête. Il faut différencier la "têt
attachée" de la "tête serrée"(
calendé ou casserole, ces dernières ne se défont pas,
elles sont
portées comme un chapeau. Autrefois la façon de nouer la « têt » en
faisant apparaître différentes pointes ou nœuds était chargée de
significations galantes.
La coiffe est toujours portée par nos
aînées, elle symbolise les circonstances de la vie, et de la richesse personnelles
!
Par la suite la coiffe devint un symbole, un langage, une fonction, un
signal, grâce à leur façon de la nouer
.
Cette symbolique du langage de la coiffe a perduré
jusqu’à nos jours , selon le nombre de pointes,
l'on sait si la femme
qui la porte est mariée, célibataire , amoureuse, ou si elle veut
être provocante.
Les hommes étaient capables de
déchiffrer immédiatement les messages codés des femmes par le nombre
de pointes élevées sur la coiffe.
Il existe d'autres coiffes, comme celle de la
"Matadore,"
femme entretenue de Martinique, qui se parait de bijoux offerts
par leur homme.
La
tête de la "Matadore du Sud" a un éventail
devant et derrière la coiffe. 
La
tête de la "Matadore de St Pierre" est
composée d'un petit triangle devant et d'une queue plissée
derrière.
La
tête "Chaudière" est
de forme arrondie toute plissée à plat.
La tête
"calandée" est
confectionnée à partir d'un madras sur lequel les parties claires du
tissu ont été peintes avec un jaune de chrome en poudre additionné
de gomme arabique. Cette technique venue des Indiens donnait de
l'éclat au madras, elle se pratiquait autrefois non pas avec des
pinceaux, mais des plumes de poule. Les tenues traditionnelles sont
portées avec une multitude de bijoux en or, les colliers se
superposent et même les coiffes en sont parées.
|
 |
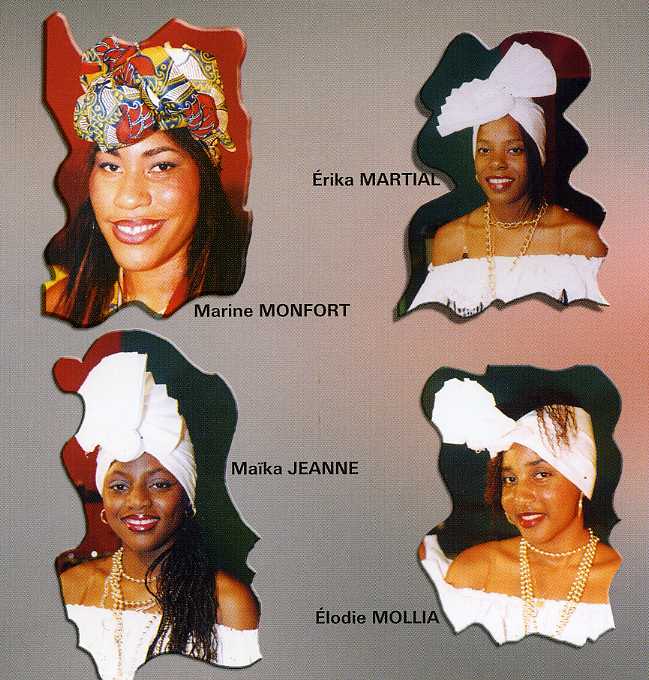 |
 |
 |
 |
|
|
 La façon dont est nouée la coiffe à
pointes ou à bouts, carrés de madras attaché autour de la tête,
révèle aussi la disponibilité sentimentale de l'Antillaise. La façon dont est nouée la coiffe à
pointes ou à bouts, carrés de madras attaché autour de la tête,
révèle aussi la disponibilité sentimentale de l'Antillaise.
Une pointe :
cœur à prendre
Deux pointes : déjà conquise
Trois pointes : mariée
Quatre pointes : mariée, mais
vous pouvez tenter votre chance.
|
|
|
La
coiffe
Accessoire indispensable du costume créole,
la coiffe reflète
tantôt la situation sociale tantôt la situation matrimoniale de la
femme.

Appelé aussi têtes, elles sont faites à partir d’un carré de
tissu madras* bien amidonné que l’on pose sur la tête en diagonale.
Attaché solidement à l’arrière, on croise les deux bouts et on les
fait revenir en avant .

On redresse, noue les pointes en les
épinglant. Au commencement des lois interdisaient aux
affranchies de
porter des chapeaux. Le port du foulard étant ressenti comme une
humiliation, les femmes créoles adoptèrent la coiffe de madras,
carré de tissu noué autour des cheveux.
Au fil du temps, la coiffe
s’est créé son propre langage en fonction du nombre de pointes, on
sait si la femme qui la porte est mariée, célibataire, amoureuse ou
provocante.
La manière de porter sa coiffe
varie selon l'âge et les circonstances:
Les fillettes , en général, portaient
un foulard de soie, de teinte vive, tendu sur le front et relevé
derrière la tête pour mettre à découvert leurs cheveux nattés et
roulés avec soin.
Vers 18 ans, la jeune fille "prend
tête", comme on dit en créole. Autrement dit, elle échange le
foulard contre le madras.
 En période de deuil, au lieu du madras, les intéressés adoptent un
mouchoir blanc; aussi choisi par les femmes âgées qui ont dit adieu
aux joies et illusions de la vie... En période de deuil, au lieu du madras, les intéressés adoptent un
mouchoir blanc; aussi choisi par les femmes âgées qui ont dit adieu
aux joies et illusions de la vie...
Les coiffes spécifiquement guadeloupéennes :
-
tête
casserole - tête créole
- tête plombière
Les bijoux sont un
indispensable complément du costume.
Aujourd’hui le costume créole est
démocratisé on le porte lors des
grands évènements ( mariage, baptêmes ..) et lors des fêtes
traditionnelles ( Lewoz ). Mais il a su aussi se moderniser
|
|
|
 De fil en aiguille De fil en aiguille
Exposition sur
le costume créole de 1700 à 1950
|
|

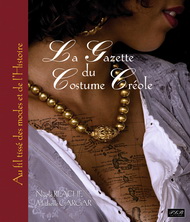
La Gazette du costume créole se
lit et s’ouvre comme une malle oubliée depuis des siècles
|
Le Madras,

A partir duquel
étaient fabriqués les costumes créoles, est aujourd’hui utilisé
pour réaliser de nombreux vêtements (robes, chemises, paréos...)
Un souvenir "prêt-à-porter" !
Le
madras est le tissu traditionnel des Antilles. Il a été apporté
par les premiers travailleurs indiens avant de devenir l'élément
essentiel du costume traditionnel antillais. Il tire son nom de
la ville du même nom, en Inde. Il est fait de coton, avec des
fils de couleurs aussi éclatants que variés qui forment des
carreaux et des rayures.

Aujourd'hui,
le madras trouve sa place dans la mode actuelle. Il est utilisé
pour la confection de prêt-à-porter, de sac
à main, de paréos et
autres accessoires de mode.
On l'utilise aussi très souvent pour
décorer la maison, en confectionnant,
par exemple,
des nappes et des
rideaux.
Ce nom vient de l’ancienne ville
de Madras, en Inde (Madras, ancienne dénomination de la ville
indienne de Ch ennai). Elle était donc fabriquée pendant la
colonie britannique, qui y a importé ces motifs inspirés des
tartans écossais. ennai). Elle était donc fabriquée pendant la
colonie britannique, qui y a importé ces motifs inspirés des
tartans écossais.
C'est un tissu de coton aux fils
de couleurs vives formant des carreaux ou des rayures, utilisé
traditionnellement aux Antilles.
En Guadeloupe
comme en Martinique, le costume
traditionnel féminin est un véritable langage et une indication
sur la vie sentimentale
 de la femme Antillaise tout en mettant
en relief sa beauté (coiffe madras, bijoux créoles, tenue
antillaise). de la femme Antillaise tout en mettant
en relief sa beauté (coiffe madras, bijoux créoles, tenue
antillaise).
Le port du chapeau étant
interdit au temps de l'esclavage, les Antillaises ont adopté la
coiffe créole en madras comme signe distinctif de beauté.
|
|

GRAVURE du 19 ° siècle
sur papier fin d'époque vers 1835
COSTUME CREOLE en 1835
ANTILLES FRANCAISE
18 cm x 26 cm |
 |
|
|
|
 |
|
 |
|

Collier forçat |
|

Collier-choux
|
|
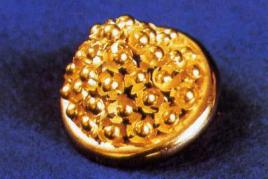
Pomme
canelle |
 |
|
  |
|
|
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
|

Le bijou créole
est plus que tous les autres artisanats
intimement liés aux aspirations d’une grande partie de la société
locale.
Il a été pour les esclaves le symbole de leur ascension sociale
dans un système qui ne les favorisait pas et le seul luxe des
populations campagnardes qui ne pouvaient investir dans la
terre.
Ce sont les esclaves domestiques, nourrices (la da), chambrières
ou favorites du maître qui arborent les plus anciennes parures
d’or qui remplacent peu à peu la verroterie du 17ème siècle.

La coutume voulait que les enfants des familles riches
remercient la « da » qui les avait élevés en lui offrant à chaque
anniversaire ou étrenne un ou plusieurs grains d’or ouvragés.
Montés en longs colliers, ils témoignaient de ses bons et loyaux
services.
Les artisans bijoutiers créoles se sont inspirés de deux sources
d’influence pour leurs modèles : les différents styles français
et les traditions africaines du travail, des métaux.
Ils portent des noms très symboliques inspirés de l’histoire, de
la faune et de la flore locale : pomme cannelle, "tété"
négresse, chaîne forçat, collier grain d’or, broche "nid de
guêpes", collier chou, etc.
Les colliers
De formes variées, les colliers constituaient l'élément
principal de la parure ; pouvant atteindre parfois 7 mètres, ils
couvraient pratiquement le cou.
Certains, comme d'autres bijoux, ont traversé les siècles et
sont fabriqués par nos bijoutiers dans des proportions plus
modestes. On distingue ainsi
Le forçat :
ce collier est composé de paires de mailles ovales, creuses et
emboîtées chaque paire étant composée d'une maille lisse et
d'une maille striée.
Il peut être porté en ras-de-cou, en collier ou en sautoir
(forme la plus courante anciennement), rappellant symboliquement
la chaîne de l'esclave. Il était offert en gage d'attachement à
la femme aimée. Les mailles de ce collier peuvent être de
dimension variée.

Le Collier-choux :
est formé d'une succession de boules d'or enfiléé sur une chainette. Chaque boule est composée de deux demi-sphères
striées de même diamètre et soudée l'une à l'autre.
Anciennement, ce collier accompagnait plus particulièrement la
tenue jupe-chemise et pouvait faire trois à quatre fois le tour
du cou. Les boules creuses et légères donnent à ce bijou la
fragilité d'une coquille.
Le Collier grain d'or
: Enfilade de boules d'or lisses et rondes, creuses ou pleines,
ce bijou rappelle par son apparence le collier de perles.
Celles-ci étant interdites aux gens de couleur, on pense que les
artisans bijoutiers ont inventé un bijou les imitant.
Autrefois, on le portait en plusieurs rangs autour du cou. Il
existe actuellement des variantes qui sont plus ou moins
récentes : le ras-de-cou aux grains de grosseurs dégradée, le
sautoir aux grains espacés, et toute une variété aux grains de
différentes grosseur ou alternée avec des perles, des grenats,
des grains choux...
Le collier «Gros-sirop»
est une succession de deux doubles mailles soudées, emboîtées
les unes dans les autres ; utilisé plutôt en sautoir, avec
cassolettes, il accompagnait la grande robe de cérémonie.
La «Marchande de sirop»
: est un collier plus rare qui accompagnait aussi la robe de
cérémonie. Il est composé d'une suite de deux petites bagues
plates striées et emboîtées : l'une est posée à la verticale,
l'autre à l'horizontale.
Le collier gourmette ou à mailles plates
: comprend des mailles creuses soudées les unes aux autres avec
alternance d'une maille biseautée et d'une maille lisse.
La chaîne torsadée :
est formée de fil d'or noué en torsade rappellant une corde :
elle est très courante en Afrique du Nord. Elle est le plus
souvent portée en sautoir ou en ras-de-cou.
Il existe une nouvelle variante plus récente ; la torsade
dégradée portée en ras-de-cou.

Le collier à mailles concombre.
Ce sont des mailles ovales avec un entrelacement de filigranes à
l'intérieur, monté de façon espacée sur une chaîne à petites
mailles rondes.
Les colliers «corail» et grenat
: utilisent l'un, des pierres (grenats taillés à facettes)
venant du Vénézuéla ou de Tchécoslovaquie, l'autre des coraux
taillés en baguettes ou en perles, enfilées sur une chaîne d'or
ou un fil de coton pour les moins aisés.
Le corail et plus tard l'ambre, étaient portés pour leur vertu
thérapeutique (bonne circulation sanguine, régulation de la
tension...).
Les barillets et les cassolettes.
Élément primordial du collier, le barillet sert en général de
fermoir : richement ouvragé et de différente grosseur, il se
porte le plus souvent à l'avant du collier. On distingue trois
types de barillets - le barillet octogonal à facettes lisses ou
à motif.
- le barillet en forme de noix le plus souvent à rainures
incrustées.
- le barillet ouvragé à fleurs et à pierres incrustées.
Les cassolettes, d'origine d'Afrique du Nord, sont des
médaillons richement ouvragés, agrémentés de pampilles ; elles
sont plus particulièrement portées avec la longue chaîne
torsadée ou gros sirop, accompagnant la grande
robe de cérémonie.
Les bracelets
Ils sont le plus souvent assortis aux colliers sauf
- le bracelet grain d'or : formé de plusieurs rangs de
demi-sphères de grains d'or reliées entre elles par une
chaînette.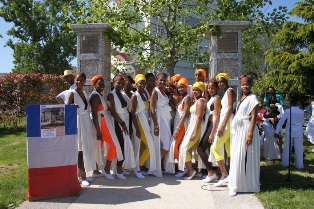
- le jonc rond : qui est un grand anneau d'or creux, s'ouvrant à
demi par un mécanisme permettant de l'enfiler : les deux moitiés
du bracelet étant liées pour la sécurité par une chaînette.
- le jonc plat : présente les mêmes caractéristiques. Il est
beaucoup plus large et porte parfois des motifs ou une chenille
sur sa face externe.
- le bracelet esclave est la réplique en or de l'original. Son
fermoir porte un petit bout de chaîne rappellant les mailles de
la chaîne d'esclave.
Les bijoux de «la tête»
On compte les épingles en or, les barrettes et l'épingle
tremblante
- les épingles en or : véritables épingles à cheveux, les
épingles en or sont parfois surmontées de trois petits cercles -
ou alors d'un croissant de lune serti de petites pierres.
Souvent portées par paire, reliées entre elles par une
chainette, on les mettait à l'arrière de la tête sous la coiffe
calendée, accompagnant la tenue de cérémonie.
- les barrettes en or : toujours portées par paire de part et
d'autre de la tête sur les deux nattes supportant la tête
calendée, elles étaient particulièrement de forme ovale et
filigrane.
- l'épingle tremblante : très rare dans les cassettes de bijoux,
celle-ci se mettait sur la tête calendée à l'avant de la tête.
Composée de trois fils d'or torsadés, faisant ressort et se
rejoignant à la base par un grain d'or auquel était soudée une
pointe, l'épingle tremblante portée par les das, comportait à
son extrémité tantôt un brin de cheveux tantôt une dent de lait
de l'enfant cajolé.

Les hommes non plus ne sont pas oubliés bien que peu nombreux,
les bijoux pour homme comptent quelques pièces qui peuvent selon
la fortune, être plus ou moins extraordinaires, notamment la
chaîne de montre, l'épingle à cravate sertie ou non d'une pierre
ou d'une perle, les boutons de col et de manchettes.
Nous devons aussi signaler pour les bébés, les boutons en or
liés entre eux par un fil rouge ou blanc, que l'on enfilait au
dos des brassières.
Lyne-Rose Beuze et George Louis-Régis Psyché |
contact kamaniok
Tél 06 46 02 15 35
|
|
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|